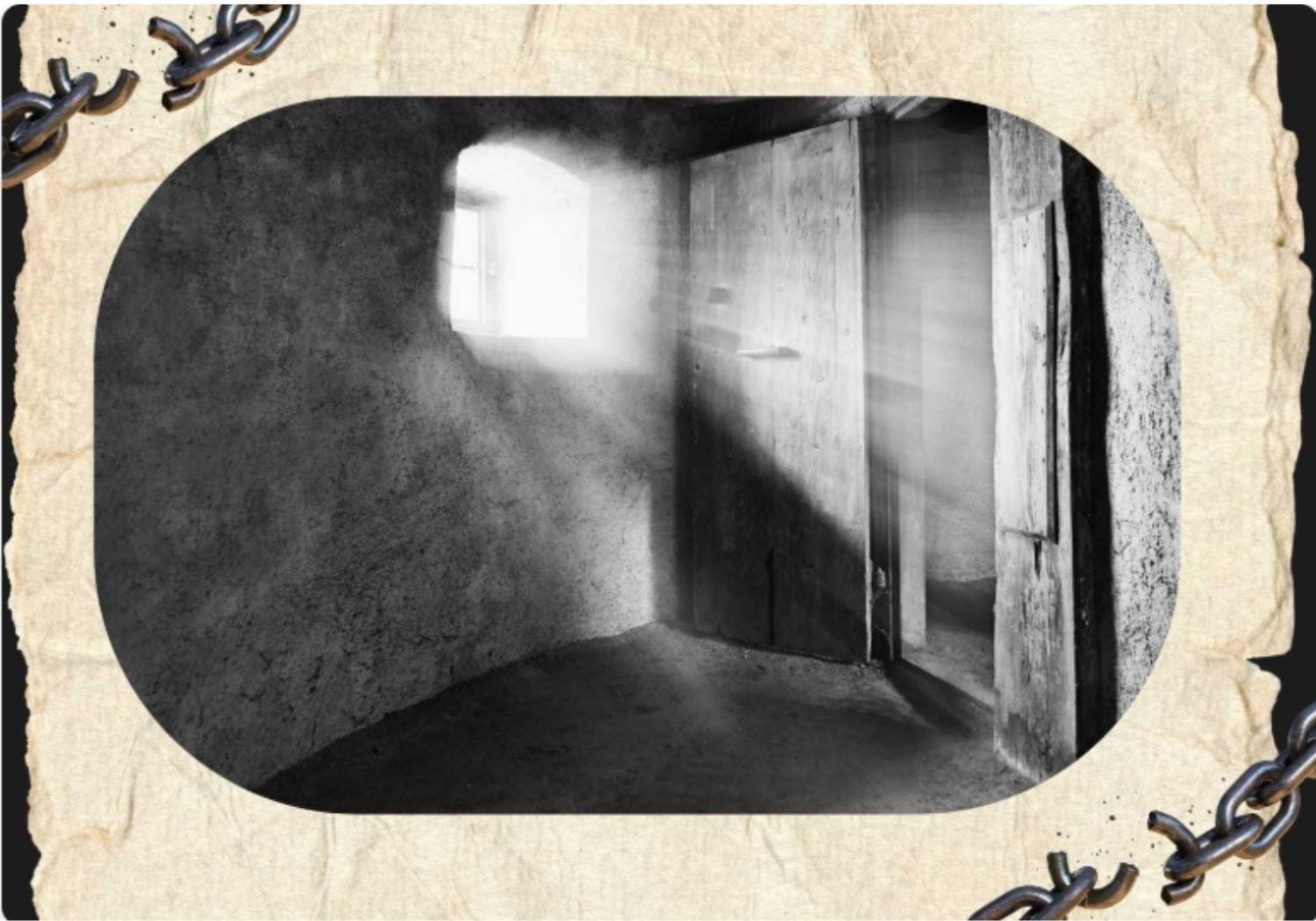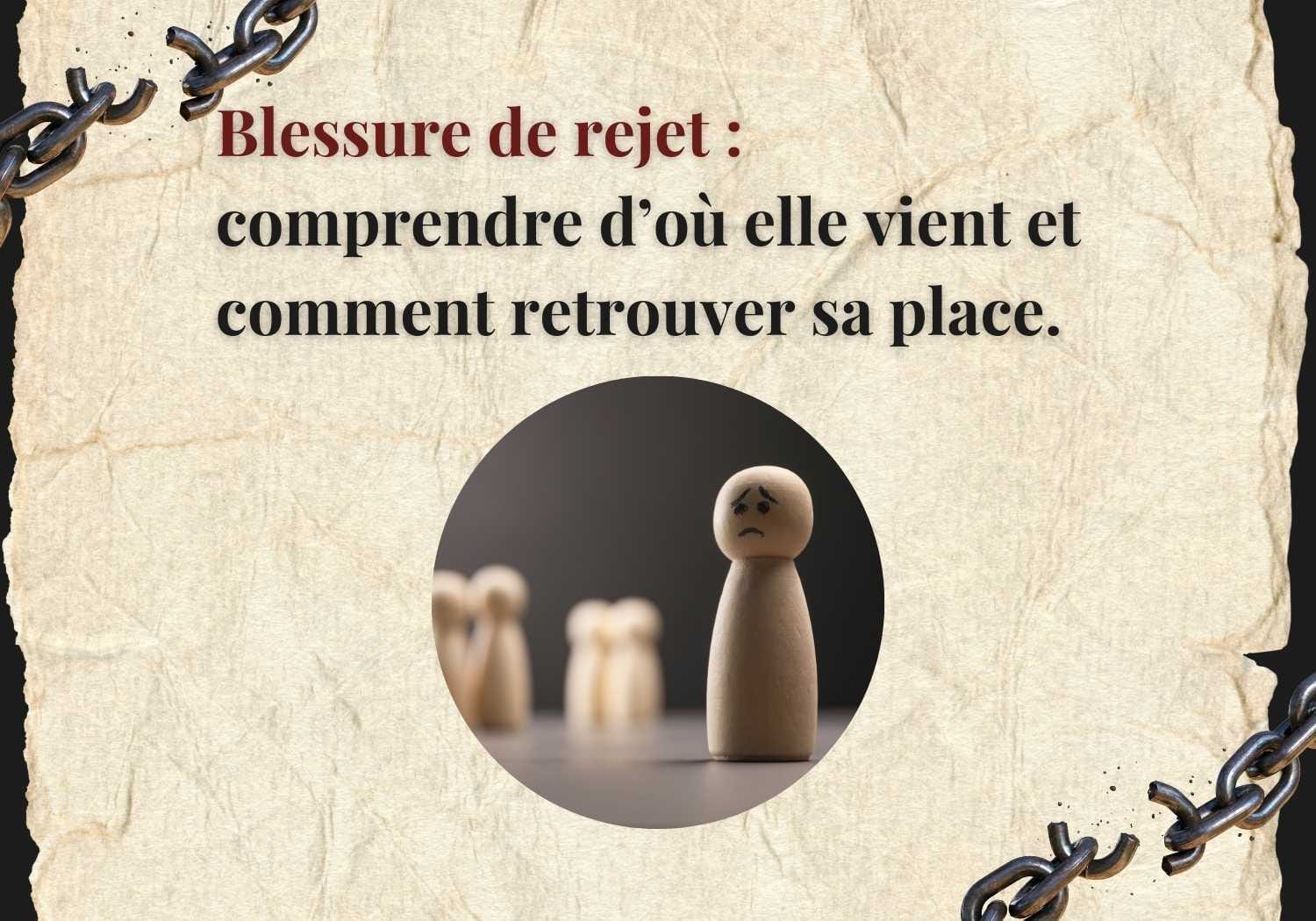Éveiller, Comprendre, Libérer.
Pour ne plus transmettre ce qui vous a détruit.

Blessure d’abandon : comprendre ses racines et apprendre à créer des liens sécurisés
La blessure d’abandon est l’une des plus fréquentes et des plus douloureuses, mais aussi l’une des moins bien comprises.
On pense souvent qu’elle ne concerne que les enfants qui ont vécu un départ brutal, un divorce ou une séparation.
En réalité, elle peut naître dans des situations beaucoup plus subtiles : un parent souvent absent à cause du travail, une mère ou un père présent physiquement mais indisponible émotionnellement, une attention qui se retire trop tôt.
Ce qui marque l’enfant, ce n’est pas seulement l’absence réelle, c’est le sentiment que la présence n’est jamais acquise.
Il grandit avec l’idée que l’amour peut s’interrompre du jour au lendemain, que la sécurité dépend d’un fil fragile.
À l’âge adulte, cette mémoire se traduit par des comportements difficiles à comprendre : peur panique de la solitude, dépendance affective, jalousie, besoin d’être rassuré en permanence, ou au contraire tendance à fuir dès qu’une relation devient sérieuse.
Derrière ces attitudes opposées se cache la même peur : revivre une perte déjà inscrite dans l’histoire.
Dans cet article, nous allons explorer en profondeur cette blessure :
ses origines dans l’enfance,
ses effets sur le corps,
son impact dans les relations amoureuses,
sa transmission transgénérationnelle,
et les chemins concrets pour commencer à s’en libérer.
Qu’est-ce que la blessure d’abandon ?
La blessure d’abandon apparaît lorsque l’enfant vit ou ressent une rupture du lien avec la personne qui représente pour lui la sécurité.
Cela peut être un parent qui part, mais aussi un parent présent en surface et pourtant absent émotionnellement.
Dans les deux cas, l’enfant enregistre la même chose : « je ne peux pas compter sur la présence de ceux que j’aime ».
Il est important de distinguer la blessure d’abandon de la blessure de rejet.
Le rejet touche à l’identité : « je ne suis pas assez bien pour être aimé ». L’abandon, lui, touche au lien : « même si on m’aime, on peut partir ».
Cette insécurité de fond pousse l’enfant à développer des stratégies de protection.
Certains deviennent très dépendants, cherchant à tout prix à maintenir le lien, même au prix de leur liberté. D’autres choisissent l’attitude inverse : ils se ferment ou fuient avant de risquer d’être quittés.
En séance, j’entends souvent des phrases comme :
« Je ne supporte pas quand il ne répond pas tout de suite à mes messages. »
« J’ai besoin d’être rassuré en permanence, sinon je panique. »
« J’aime, mais je me protège en ne m’attachant pas trop. »
Ces mots traduisent la même mémoire : celle d’un amour vécu comme fragile, incertain, toujours menacé.
Découvre l'article complet sur la blessure de rejet ci-dessus
L’abandon dans l’enfance : les premières fissures.
La blessure d’abandon s’installe très tôt, souvent bien avant que l’enfant puisse mettre des mots sur ce qu’il ressent.
Elle prend plusieurs formes :
L’abandon physique, quand un parent s’absente durablement à cause d’un divorce, d’une maladie, d’un deuil ou d’un placement.
L’abandon émotionnel, quand le parent est présent mais indisponible, absorbé par ses propres difficultés.
L’abandon symbolique, quand l’enfant se sent moins aimé qu’un frère ou une sœur, quand il est comparé, critiqué ou ignoré.
Pour un adulte, ces situations peuvent sembler légères ou justifiées par la vie.
Pour un enfant, elles touchent directement à sa survie affective. Il n’interprète pas l’absence comme une circonstance extérieure, mais comme un manque de valeur personnelle : « si papa ou maman ne reste pas, c’est que je ne le mérite pas ».
C’est dans ces moments que naissent les premières fissures de l’estime de soi.
L’enfant se construit avec la conviction que la présence de l’autre n’est jamais acquise, qu’il faut soit la retenir à tout prix, soit se préparer à la perdre.
Pour se protéger, il développe des stratégies :
Devenir dépendant, en s’accrochant de toutes ses forces à la moindre présence.
Devenir autonome trop tôt, en étouffant ses besoins pour ne plus risquer de souffrir.
Se créer un faux-self, un masque d’enfant sage, serviable, sans exigence, qui permet de garder le lien mais efface la vérité de ses émotions.
En grandissant, ces stratégies deviennent invisibles mais puissantes.
Un adulte qui a appris enfant à “ne pas déranger” peut être perçu comme fiable et solide, mais intérieurement il vit avec une peur constante d’être abandonné s’il exprime un besoin.
Inscrivez-vous à la newsletter
Comment savoir si vous avez été marqué par l’abandon dans l’enfance ?
Voici quelques signes fréquents :
Une peur panique de la solitude ou du silence.
Le besoin d’être constamment rassuré dans vos relations.
La sensation d’avoir dû “grandir trop vite”.
La tendance à fuir ou saboter une relation dès qu’elle devient sérieuse.
Un sentiment persistant de vide ou d’insécurité intérieure.
👉 Si plusieurs de ces points résonnent avec votre vécu, il est possible que la blessure de l'abandon fasse partie de votre histoire. L’important n’est pas de vous étiqueter, mais de reconnaître ce ressenti afin d’entamer un processus de compréhension et, peu à peu, de transformation.
La mémoire corporelle de l’abandon
Un enfant ne garde pas toujours de souvenirs précis de ses expériences précoces, mais son corps, lui, enregistre tout.
C’est ce que de nombreux patients découvrent en thérapie : ils affirment ne pas se souvenir d’événements marquants, mais leur corps raconte une autre histoire.
Comment le corps enregistre l’abandon
Quand le lien affectif est instable, le système nerveux de l’enfant reste en alerte.
Au lieu de connaître l’alternance normale entre détente et sécurité, il apprend à rester prêt à réagir à tout moment : un bruit, un silence, un départ.
Ce mécanisme de survie installe une vigilance constante qui ne s’éteint pas spontanément.
On retrouve souvent chez ces enfants :
des troubles du sommeil (difficulté à s’endormir seul, cauchemars récurrents),
des tensions corporelles (ventre noué, respiration courte),
des pleurs inconsolables, car l’enfant ne parvient pas à se réguler seul.
Les manifestations à l’âge adulte
À l’âge adulte, cette mémoire s’exprime autrement :
une mâchoire serrée, comme pour contenir l’angoisse,
des épaules tendues, prêtes à porter ou à se défendre,
un ventre crispé dès qu’une séparation se profile,
une incapacité à se relâcher complètement, même dans des contextes de sécurité.
Ces signes ne sont pas de la faiblesse ou un “manque de volonté”.
Ils sont l’empreinte d’un corps qui a appris à rester vigilant pour survivre à l’insécurité relationnelle.
Le paradoxe du corps protecteur
Ce qui a permis de tenir dans l’enfance devient un obstacle à l’âge adulte.
Le corps continue de réagir comme si l’abandon était toujours imminent.
On se tend quand il faudrait se reposer.
On se méfie quand il faudrait faire confiance.
On lutte quand on voudrait aimer.
Comment repérer les signes corporels de l’abandon chez soi ?
Certaines attitudes ou sensations corporelles récurrentes peuvent indiquer que la blessure d’abandon est encore active :
Vous retenez souvent votre respiration sans vous en rendre compte.
Vous avez tendance à serrer la mâchoire ou les poings, surtout dans des situations de stress relationnel.
Vous vous réveillez fatigué même après une nuit complète.
Vous avez du mal à vous détendre pleinement en présence d’autrui, même de personnes proches.
Vous ressentez un besoin de contrôle constant pour vous sentir en sécurité.
👉 Si plusieurs de ces signes résonnent avec votre vécu, cela ne signifie pas une fatalité, mais cela met en lumière l’empreinte corporelle de l’abandon. L’identifier est la première étape pour en amorcer la transformation.
L’abandon dans les relations amoureuses : partir ou s’accrocher
Dans l’intimité amoureuse, la blessure d’abandon se manifeste avec une intensité particulière.
L’adulte qui porte cette mémoire a du mal à se sentir en sécurité dans le lien : il redoute constamment que la relation s’interrompe, parfois sans raison apparente.
Les dynamiques inconscientes
Cette peur engendre plusieurs comportements typiques :
La dépendance affective : besoin de réassurance constante, jalousie, peur panique du silence ou de l’éloignement.
La fusion : chercher à être toujours collé à l’autre, craignant que la distance ne soit un prélude à la séparation.
La fuite : couper la relation avant que l’autre n’ait le temps de partir, pour éviter la douleur.
L’auto-sabotage : provoquer des conflits ou s’éloigner volontairement afin de vérifier si l’autre reste malgré tout.
Ces réactions ne sont pas choisies consciemment ; elles découlent de la logique de survie mise en place dès l’enfance.
Le faux-self amoureux
Pour éviter d’être abandonné, la personne construit un rôle : être le partenaire parfait, toujours disponible, sans besoin propre.
Ce faux-self permet de maintenir la relation, mais au prix de l’authenticité.
Plus la peur de l’abandon est forte, plus la spontanéité et les émotions véritables sont étouffées.
La répétition de l’abandon
Beaucoup de personnes choisissent inconsciemment des partenaires qui ne peuvent pas s’engager pleinement : personnes distantes, indisponibles ou instables.
Ce n’est pas de la malchance, c’est la logique de répétition : retrouver dans l’amour adulte l’absence connue dans l’enfance, dans l’espoir secret de la réparer.
Mais tant que le schéma reste inconscient, il condamne à reproduire la même douleur.
Mise en situation
En séance, j’entends souvent des phrases comme :
« Dès qu’il ne répond pas rapidement à mes messages, j’ai l’impression qu’il va me quitter. »
« Je m’accroche trop, et je finis par l’étouffer. »
« Quand la relation devient sérieuse, je pars moi-même, pour ne pas souffrir. »
Ces témoignages montrent comment la blessure d’abandon façonne les liens intimes, parfois au point d’empêcher de goûter la stabilité d’une relation.
4 comportements qui révèlent la blessure d’abandon dans le couple
Vous cherchez sans cesse à être rassuré par votre partenaire, même pour de petites choses.
Vous avez tendance à vérifier ou à surveiller ses faits et gestes pour ne pas être pris par surprise.
Vous fuyez ou trouvez un prétexte pour rompre dès que la relation devient trop engagée.
Vous vous accrochez avec intensité, de peur que l’autre se détache, au risque d’étouffer la relation.
👉 Reconnaître ces comportements ne signifie pas que vous êtes condamné à les répéter, mais que vous pouvez désormais en prendre conscience. Et la conscience est toujours le premier pas vers la transformation.
L’abandon transgénérationnel : la mémoire des séparations
La blessure d’abandon n’est pas toujours liée à l’histoire personnelle de l’individu.
Elle peut aussi être héritée, transmise silencieusement à travers les générations.
Certaines familles portent en elles des histoires de séparations brutales :
des enfants placés ou confiés à d’autres membres de la famille,
des parents partis pour le travail, l’exil ou la guerre,
des femmes laissées seules après un départ ou un décès,
des lignées marquées par des divorces, des abandons ou des absences répétées.
Ces événements, même lorsqu’ils ne sont pas racontés, laissent une empreinte.
L’enfant d’aujourd’hui peut ressentir, sans explication consciente, une peur permanente d’être quitté, comme s’il rejouait un drame ancien qui n’a jamais été mis en mots.
La transmission invisible
Dans de nombreux cas, ce n’est pas l’événement lui-même qui pèse le plus, mais le silence qui l’entoure.
Quand une histoire d’abandon n’a pas été dite ou reconnue, elle reste vivante sous forme de mémoire émotionnelle.
Cette mémoire peut se manifester ainsi :
un sentiment persistant de ne jamais être assez pour être choisi,
une difficulté à croire que la présence de l’autre puisse durer,
la tendance à se sacrifier pour “retenir” la relation,
ou encore la peur panique de la séparation sans cause apparente.
Les loyautés invisibles
Par fidélité inconsciente, certaines personnes rejouent les scénarios d’abandon vécus par leurs ancêtres.
Elles choisissent des partenaires indisponibles, reproduisent des ruptures, ou vivent dans l’angoisse de perdre, comme pour rester solidaires de ceux qui, avant elles, ont souffert de ces manques.
Ces loyautés ne sont pas des chaînes inévitables.
Les reconnaître permet de comprendre que l’on n’est pas “faillible” ou “trop fragile”, mais porteur d’une mémoire ancienne qu’il est possible de transformer.
Explorer l’abandon dans son arbre familial
Pour identifier une éventuelle transmission transgénérationnelle de la blessure d’abandon, vous pouvez vous poser ces questions :
Y a-t-il, dans votre lignée, des enfants confiés ou placés ?
Existe-t-il des histoires de départs soudains (exil, migration, travail à l’étranger, décès prématurés)
Y a-t-il des séparations conjugales ou des divorces répétés dans votre famille ?
Des ancêtres ont-ils vécu des absences prolongées ou imposées (guerre, prison, maladie) ?
Ressentez-vous une peur de la perte ou une difficulté à faire confiance, sans cause évidente dans votre propre histoire ?
👉 Ces pistes ne visent pas à trouver des coupables, mais à remettre en lumière des mémoires restées silencieuses. Les reconnaître, c’est déjà commencer à les libérer.
Comment guérir la blessure d’abandon ?
Guérir une blessure ancienne ne signifie pas effacer le passé, mais apprendre à transformer la mémoire qu’il a laissée.
La blessure d’abandon ne disparaît pas du jour au lendemain, mais il est possible d’apprendre à ne plus en être prisonnier.
Reconnaître et légitimer la peur
La première étape consiste à reconnaître cette insécurité, sans la minimiser.
Beaucoup de personnes tentent de la rationaliser (« je ne devrais pas avoir peur, tout va bien »), mais cette attitude renforce la blessure.
Légitimer sa peur, c’est accepter que ce ressenti a une logique et qu’il vient d’une histoire réelle.
Identifier ses stratégies de survie
L’hypervigilance, la dépendance affective ou la fuite ne sont pas des défauts, mais des stratégies de protection.
Les repérer, c’est pouvoir dire : « cela m’a aidé à tenir quand j’étais enfant, mais je n’en ai plus besoin aujourd’hui ».
Remercier ces stratégies permet de ne plus les subir.
Réhabiter son corps
Parce que la mémoire de l’abandon s’inscrit dans le corps, la guérison passe aussi par lui.
Apprendre à respirer différemment, pratiquer des exercices d’ancrage, développer la capacité à rester présent à ses sensations : tout cela aide le système nerveux à se sécuriser peu à peu.
Honorer ses lignées et distinguer ce qui est à soi
En psychogénéalogie, reconnaître que l’histoire familiale a pu marquer nos liens ne signifie pas rester prisonnier.
C’est honorer nos ancêtres pour ce qu’ils ont traversé, tout en choisissant consciemment d’ajouter autre chose : de la présence, de la stabilité, de la confiance.
S’autoriser l’imperfection et l’authenticité
L’un des grands pas de guérison est d’apprendre à rester dans le lien sans chercher à être parfait, sans se travestir.
Pouvoir dire « j’ai peur », « j’ai besoin », ou « je préférerais » sans craindre de perdre l’amour.
C’est ce qui permet à la relation de devenir un lieu de vérité, plutôt qu’une mise en scène.
La psychogénéalogie comme clé de transformation
En éclairant les mémoires silencieuses, elle permet de comprendre pourquoi certains comportements se répètent et comment les transformer.
Elle ne vise pas à désigner des coupables, mais à relier des histoires pour les pacifier.
Ce travail permet de reprendre sa place dans la lignée, sans rester prisonnier de ses blessures.
Pour libérer les mémoires affectives, guérir les blessures transgénérationnelles, et reconstruire un cœur libre, sans confusion.
3 premiers pas pour commencer à se libérer de la blessure d’abandon
Mettez des mots : écrivez une situation où vous vous êtes senti seul ou abandonné, puis notez ce que vous avez ressenti à ce moment-là. L’objectif n’est pas d’analyser, mais de reconnaître.
Pratiquez un ancrage corporel : chaque jour, accordez-vous 5 minutes pour respirer profondément, sentir vos appuis au sol, et répéter intérieurement : « ici et maintenant, je suis en sécurité ».
Repérez vos stratégies de protection : notez si vous avez tendance à fuir, à vous accrocher ou à contrôler. Remerciez ces comportements d’avoir été utiles, et choisissez peu à peu d’expérimenter une autre manière d’être en lien.
Conclusion
La blessure d’abandon prend racine très tôt, parfois dans des événements visibles, parfois dans des absences si discrètes qu’elles semblent insignifiantes aux yeux des adultes.
Pourtant, l’enfant en garde une empreinte durable : la peur que l’amour se retire, que la présence bascule dans le vide.
Adulte, cette mémoire se rejoue dans le corps, dans les relations, dans les choix de partenaires. Elle peut sembler condamner à revivre toujours la même insécurité.
Mais comprendre son origine change tout.
On ne subit plus la peur de l’abandon comme une fatalité ; on la reconnaît comme une histoire inscrite en nous, et que nous pouvons transformer.
Le chemin de guérison ne consiste pas à ne plus jamais avoir peur, mais à apprendre à rester dans le lien même quand la peur est là.
À se donner soi-même la sécurité qui manquait, à honorer ses ancêtres tout en choisissant d’écrire un chapitre différent.
Vous n’avez pas à mériter l’amour, ni à lutter pour conserver votre place.
Elle vous appartient déjà. Et chaque pas vers cette reconnaissance intérieure ouvre la possibilité de créer des relations plus stables, plus vraies, plus apaisées.
👉 Si vous vous reconnaissez dans ces lignes, sachez que vous n’êtes pas seul.
Mettre de la lumière sur vos blessures est déjà une forme de guérison.
Le reste du chemin peut se faire pas à pas, avec de nouveaux repères, un accompagnement bienveillant et surtout une certitude : il est possible d’aimer sans vivre dans la peur de perdre.
Discutons en ensemble, prenez rendez-vous pour une première séance, elle vous est offerte :
Découvrez d'autres articles

Découvrez mon accompagnement personnalisé.